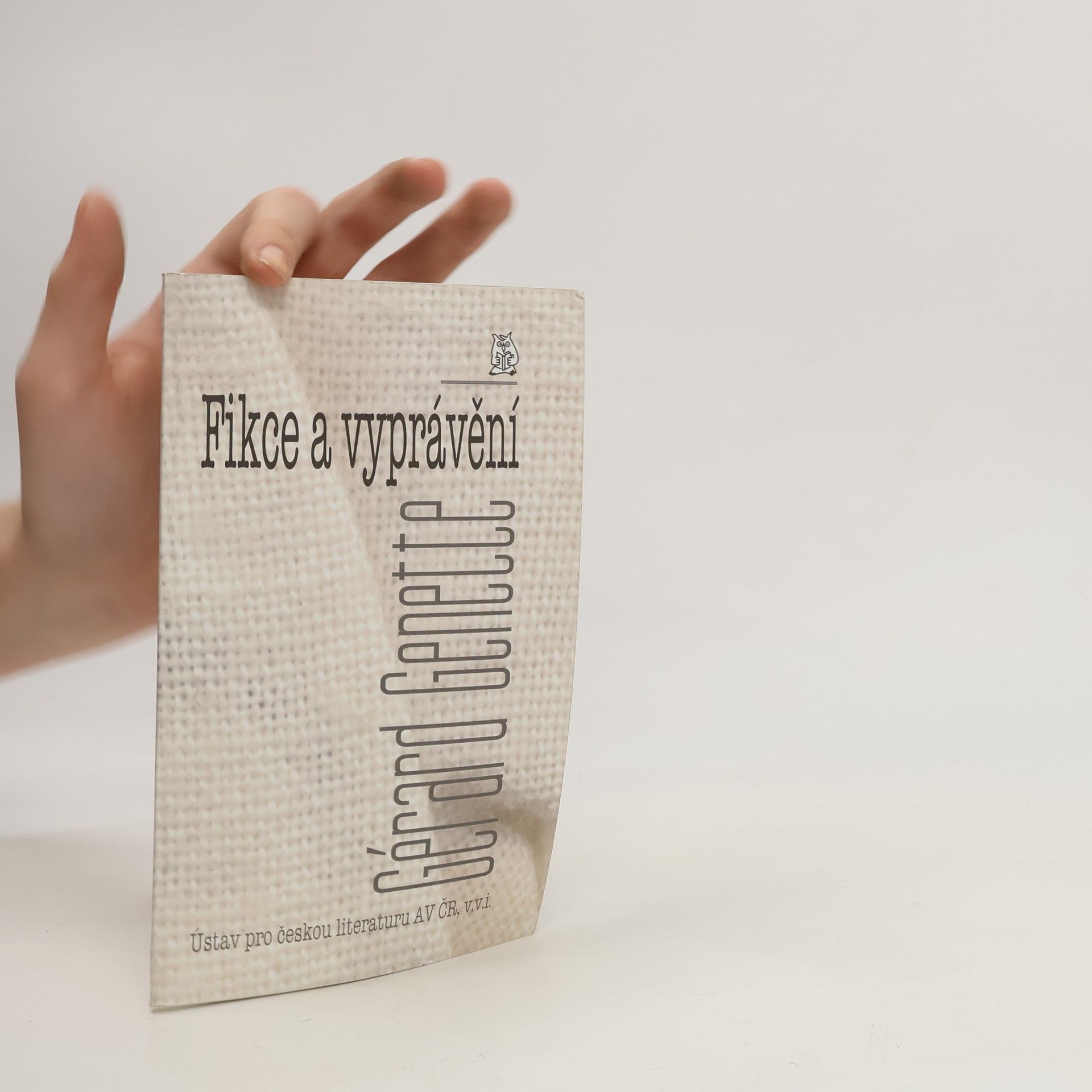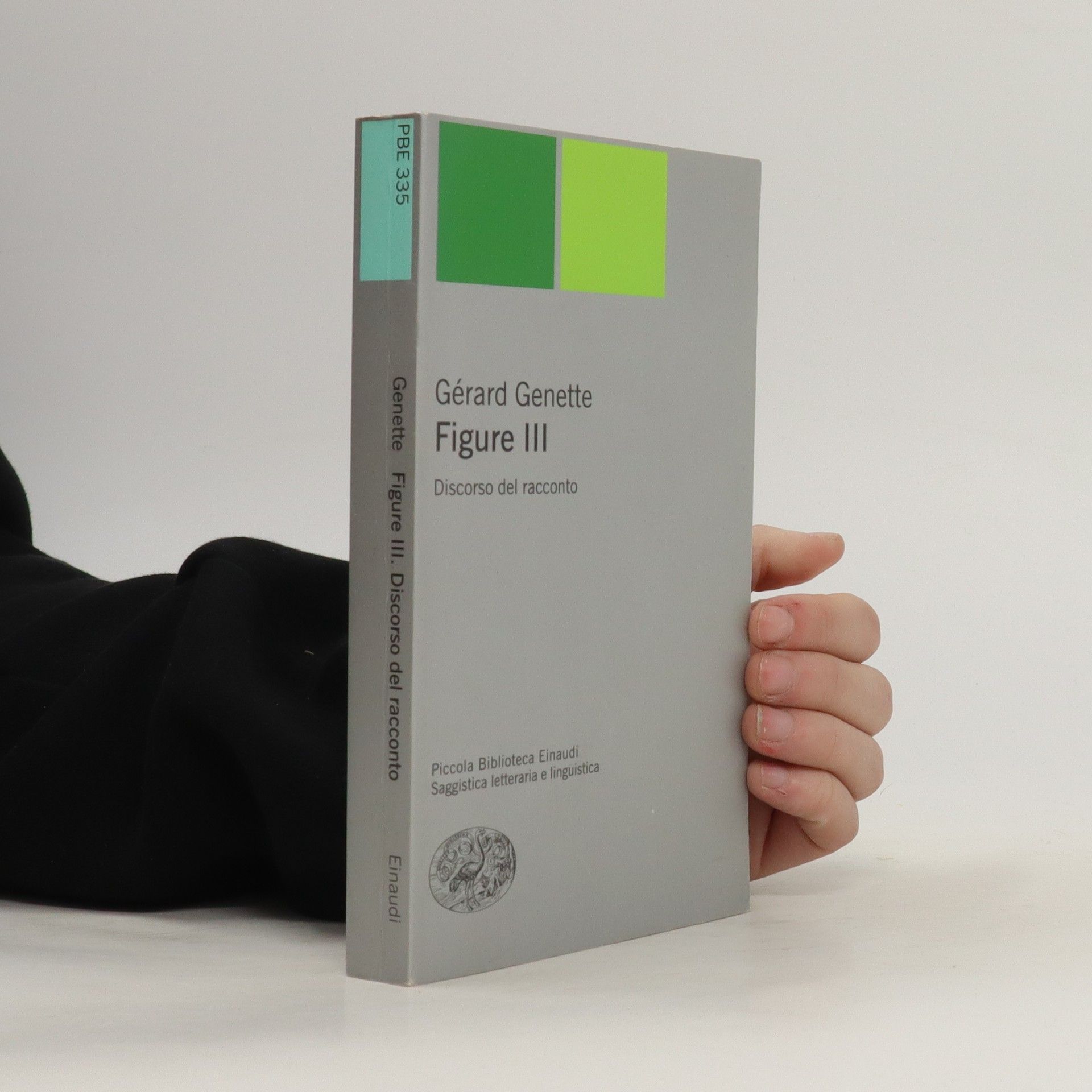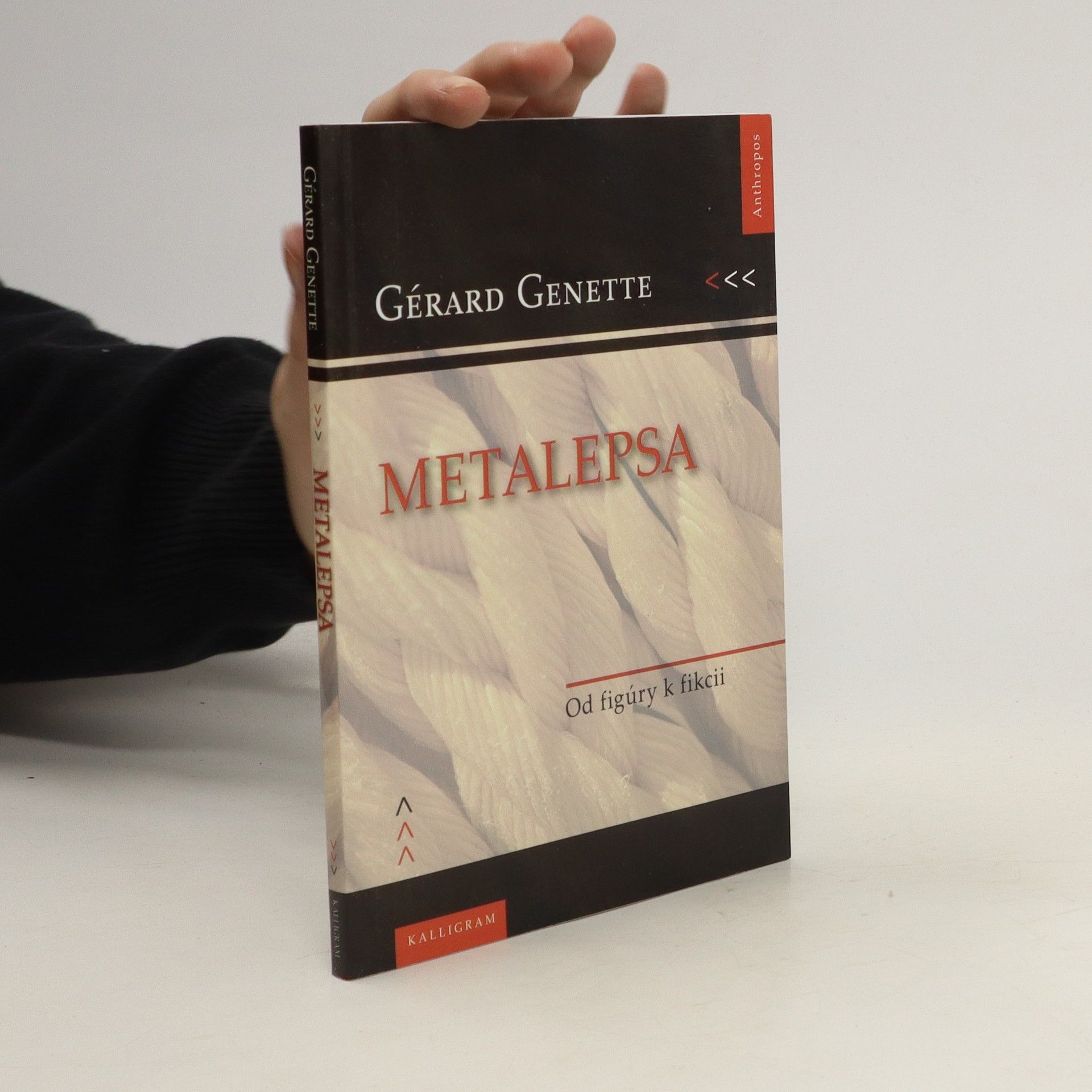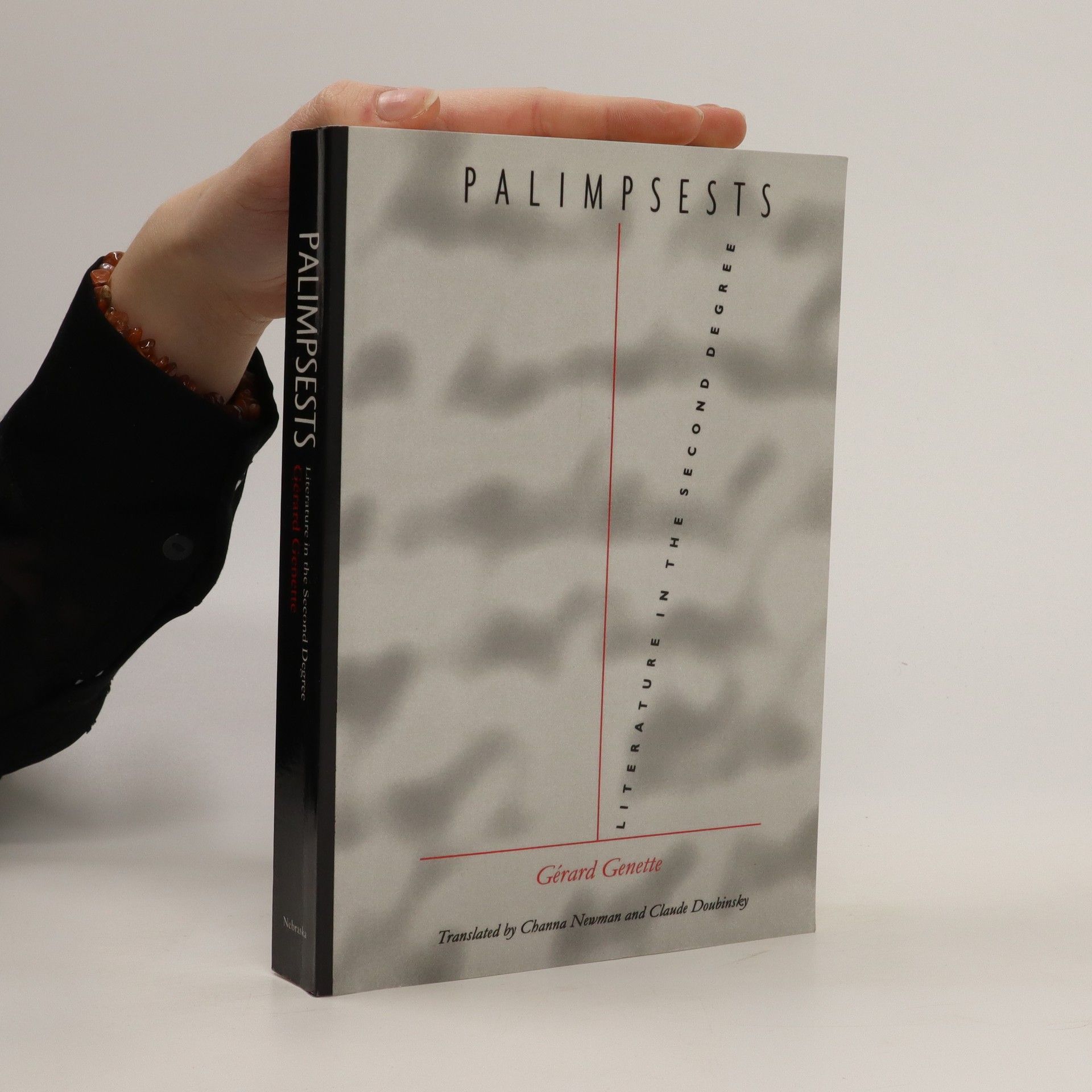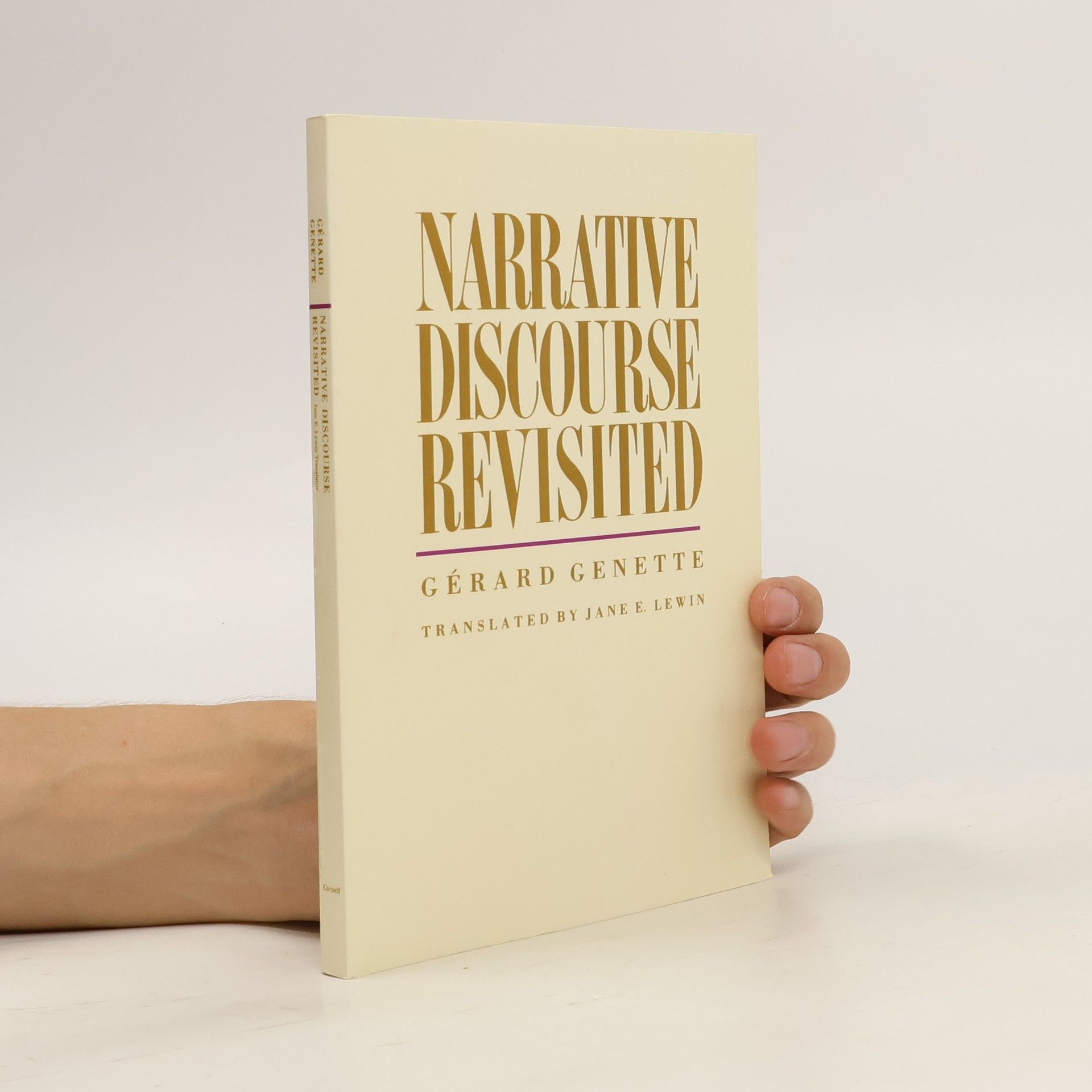Gérard Genette Ordre des livres (chronologique)
Genette fut essentiel pour réintroduire un riche vocabulaire de termes rhétoriques, tels que trope et métonymie, dans la critique littéraire. Son travail fondamental sur la théorie narrative, notamment "Narrative Discourse: An Essay in Method", a considérablement influencé la manière dont nous analysons les récits. À travers sa série en plusieurs parties "Figures" et sa trilogie explorant la transcendance textuelle, il a fourni des cadres critiques qui continuent de résonner. Bien que son œuvre soit souvent discutée dans des analyses secondaires plutôt qu'étudiée isolément, des concepts tels que 'paratexte' et 'hypotexte', issus de ses recherches, sont devenus des outils répandus pour l'interprétation littéraire.

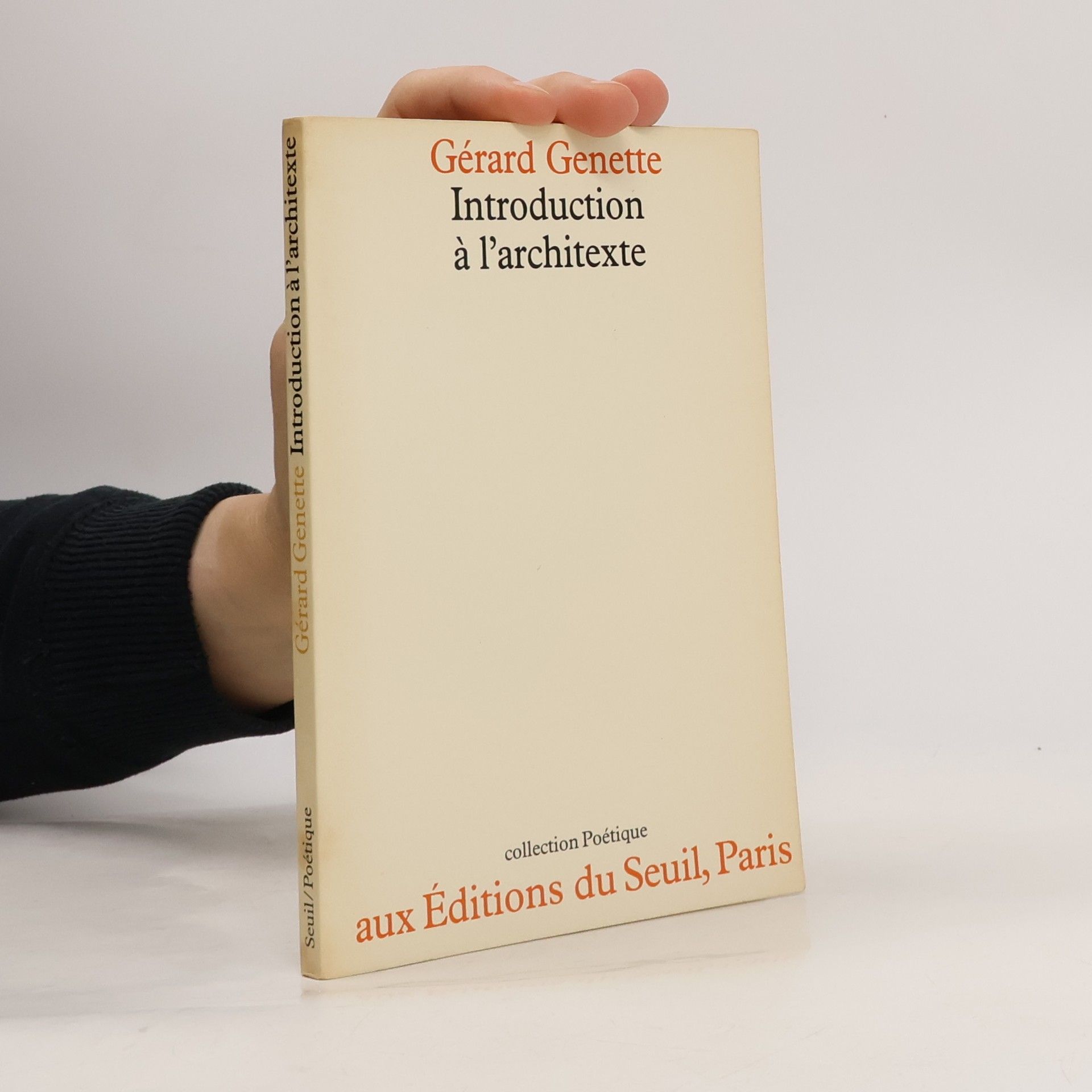
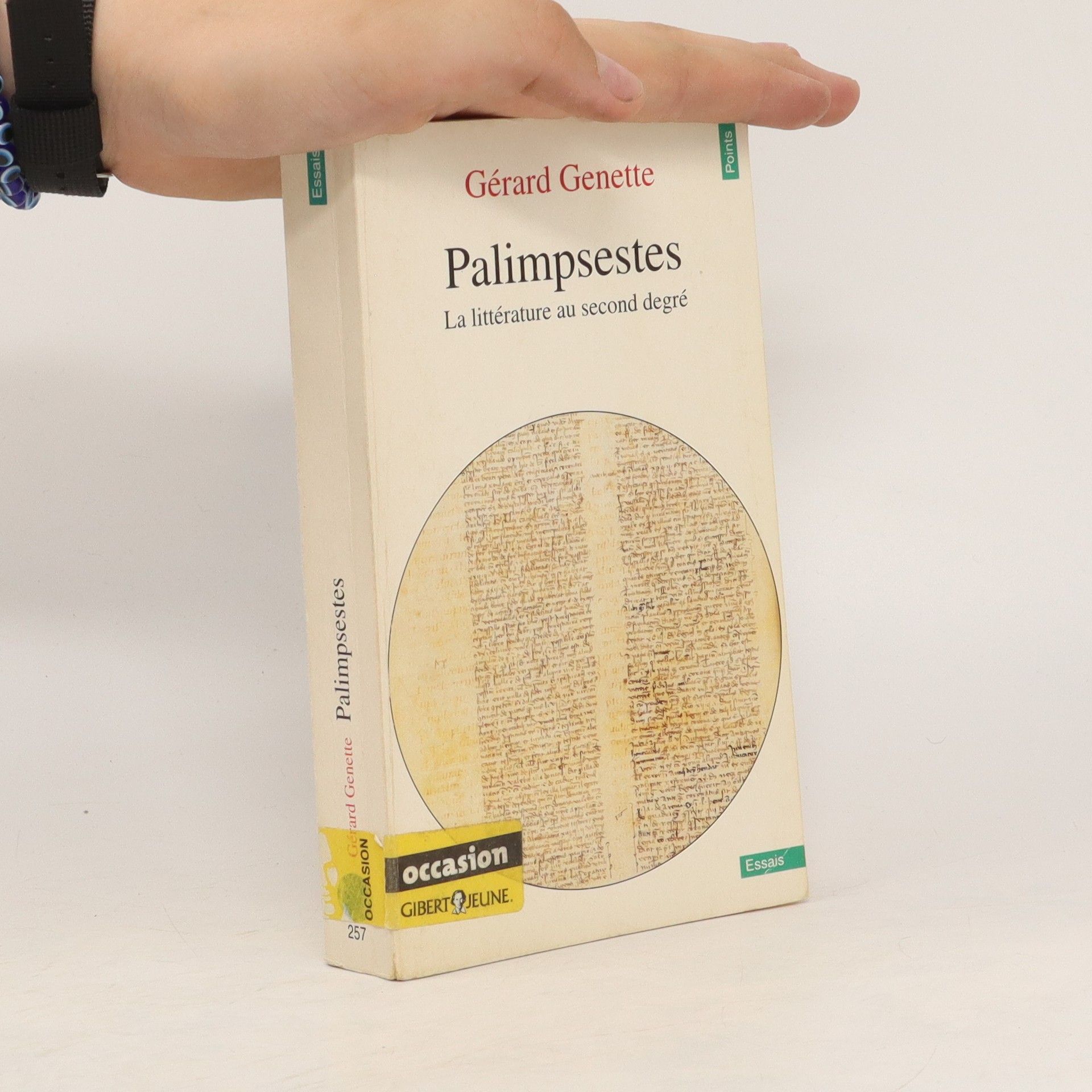
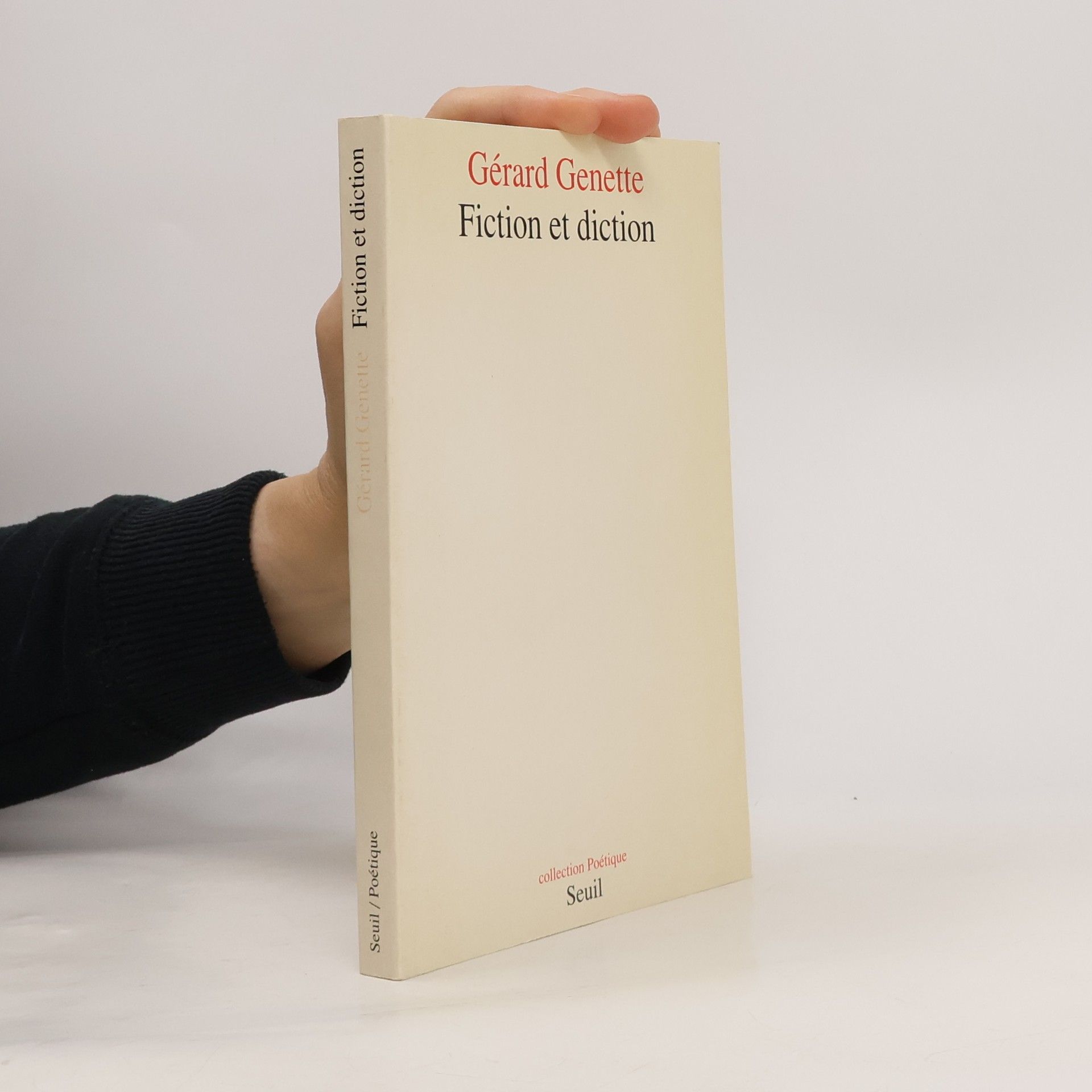
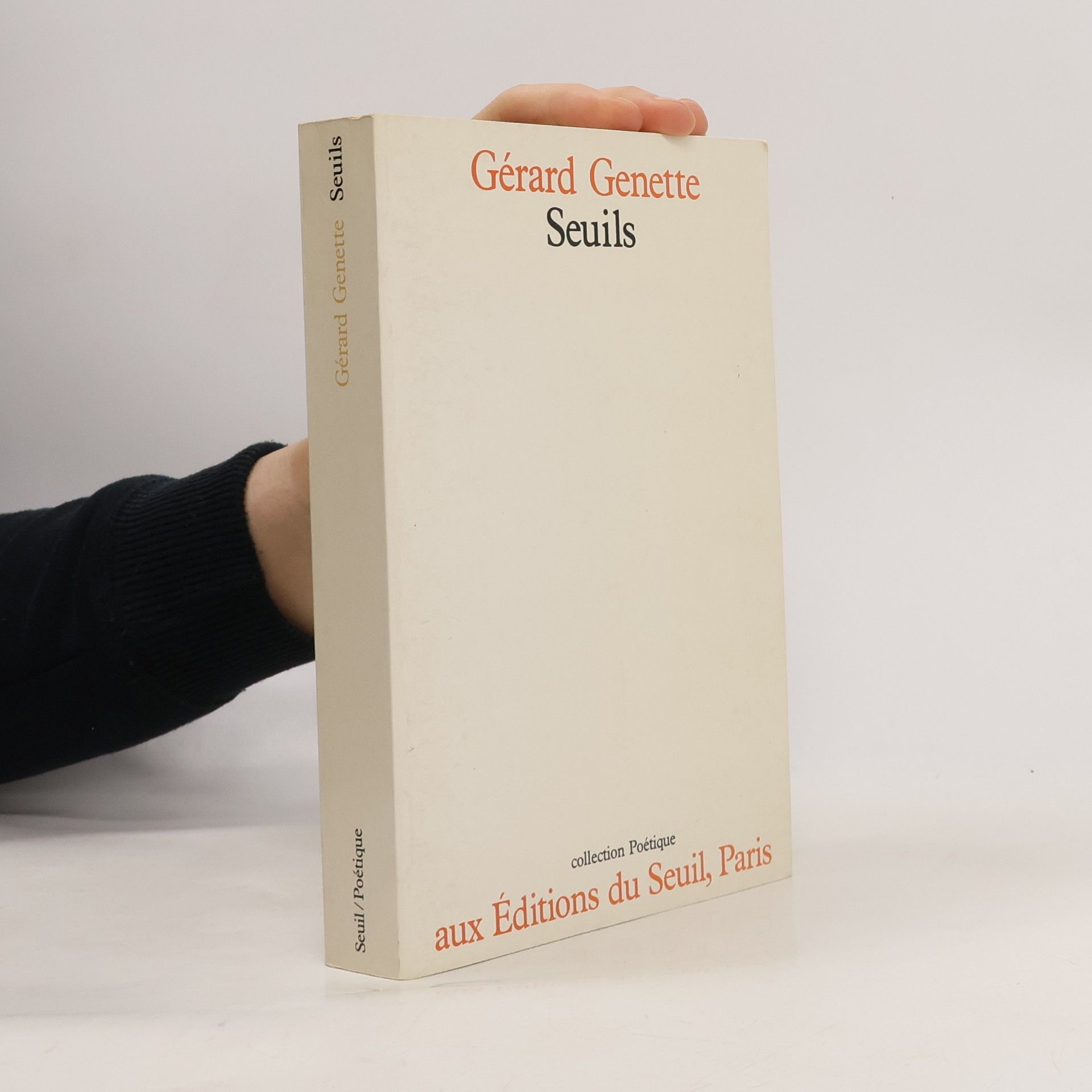
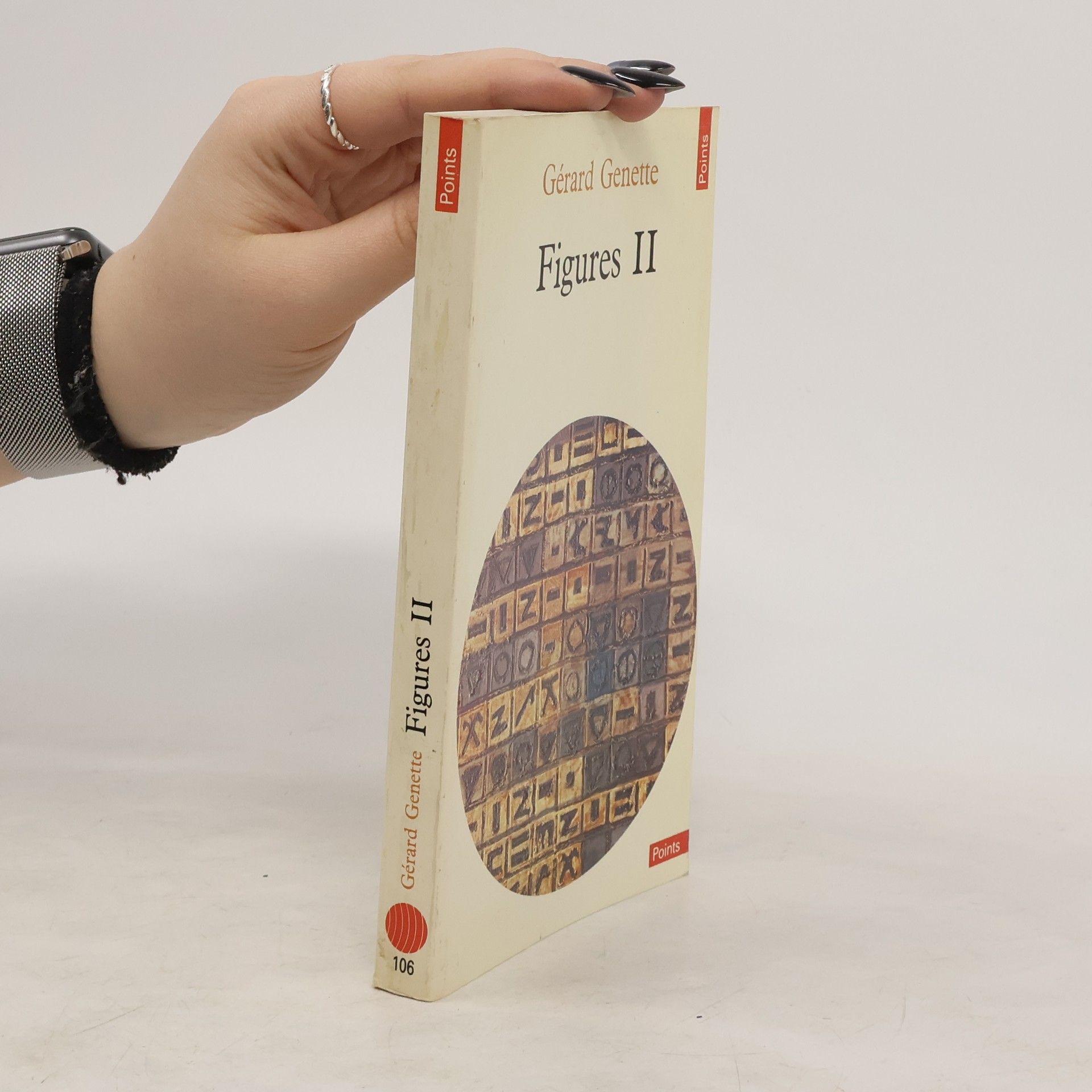
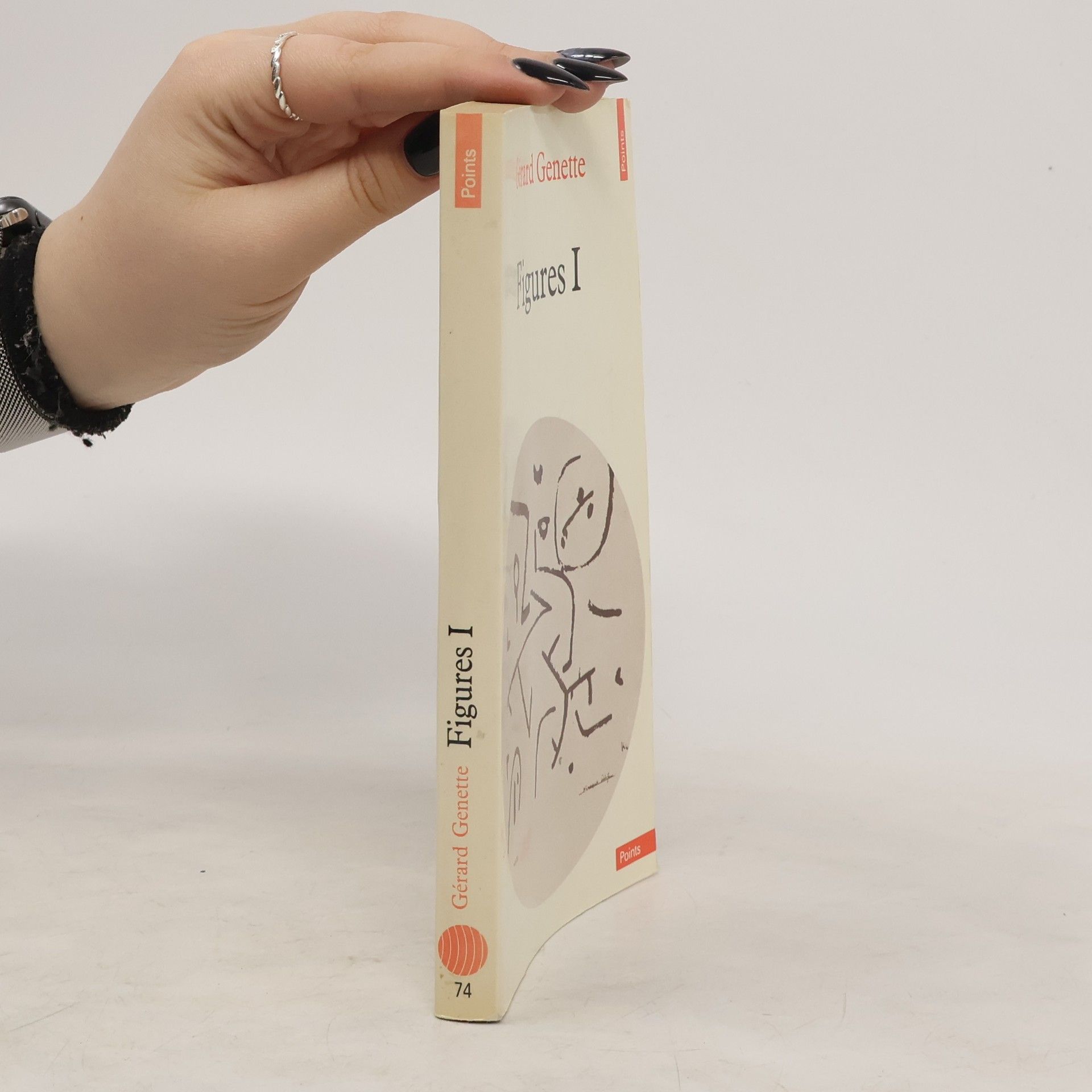
Da un continuo scambio tra le suggestioni di una teoria generale delle forme letterarie (o poetica) e i dati concreti di una tradizionale, e spesso penetrante, analisi critica nascono i saggi di Figure III. Di questa doppia anima l'autore è ben conscio; la raccolta si apre, infatti, col breve scritto su Critica e poetica, che è una riaffermazione della pari e complementare dignità di entrambe. Ad esso fa seguito una ridiscussione dei rapporti tra Poetica e storia, classico tema della possibilità di una storia letteraria, visto da una specola non italiana (ma con risultati che suonano conferma a quelli di scuola italiana). Di questa collaborazione tra poetica, nella specie narratologica, e critica, Genette dà subito prova affrontando la Recherche proustiana, prima sinteticamente, con un magistrale saggio sulla Metonimia in Proust; poi analiticamente, smontando i meccanismi narrativi dell'opera. La lezione di metodo che ne risulta ha così un merito in più: quello di dimostrarsi, fin dalla sua formulazione, utile alla comprensione di un testo straordinariamente complesso, dal quale è lecito estrarre conclusioni generali sui rapporti tra storia, narrazione e racconto.
Metalepsa: Od figúry k fikcii
- 120pages
- 5 heures de lecture
Autor známy svojimi štrukturalistickými teóriami o kritikovi a umelcovi sa v tejto knihe venuje problematike metalepsy v priestore fikcie a na príkladoch literárnych diel, píše o rozširovaní možností rozprávania, ako aj interpretácie sveta.
A palimpsest is "a written document, usually on vellum or parchment, that has been written upon several times, often with remnants of erased writing still visible". Originally published in France in 1982, Gerard Genette's PALIMPSESTS examines the manifold relationships a text may have with prior texts on the same document.
Fiction et diction
- 160pages
- 6 heures de lecture
In Narrative Discourse Revisited Genette both answers critics of the earlier work and provides a better-defined, richer, and more systematic view of narrative form and functioning. This book not only clarifies some of the more complex issues in the study of narrative but also provides a vivid tableau of the development of narratology over the decade between the two works.
Seuils
- 400pages
- 14 heures de lecture
Poétique: Nouveau discours du récit
- 128pages
- 5 heures de lecture
In Narrative Discourse Revisited Genette both answers critics of the earlier work and provides a better-defined, richer, and more systematic view of narrative form and functioning. This book not only clarifies some of the more complex issues in the study of narrative but also provides a vivid tableau of the development of narratology over the decade between the two works.
Narrative Discourse
- 288pages
- 11 heures de lecture
Gerard Genette builds a systematic theory of narrative upon an anlaysis of the writings of Marcel Proust, particularly 'Remembrance of Things Past.'Adopting what is essentially a structuralist approach, the author identifies and names the basic constituents and techniques of narrative and illustrates them by referring to literary works in many languages.