Общество потребления
- 320pages
- 12 heures de lecture
Jean Baudrillard était un sociologue et philosophe français dont l'œuvre est fréquemment associée au postmodernisme et au post-structuralisme. Sa philosophie est centrée sur les concepts jumeaux d''hyperréalité' et de 'simulation', décrivant la nature virtuelle de la culture contemporaine dominée par la communication de masse et la consommation. Baudrillard pensait que nous habitons un monde d'expériences simulées, ayant perdu la capacité de comprendre la réalité telle qu'elle existe réellement. Sa pensée explore comment la distinction entre le réel et sa reproduction est devenue floue.

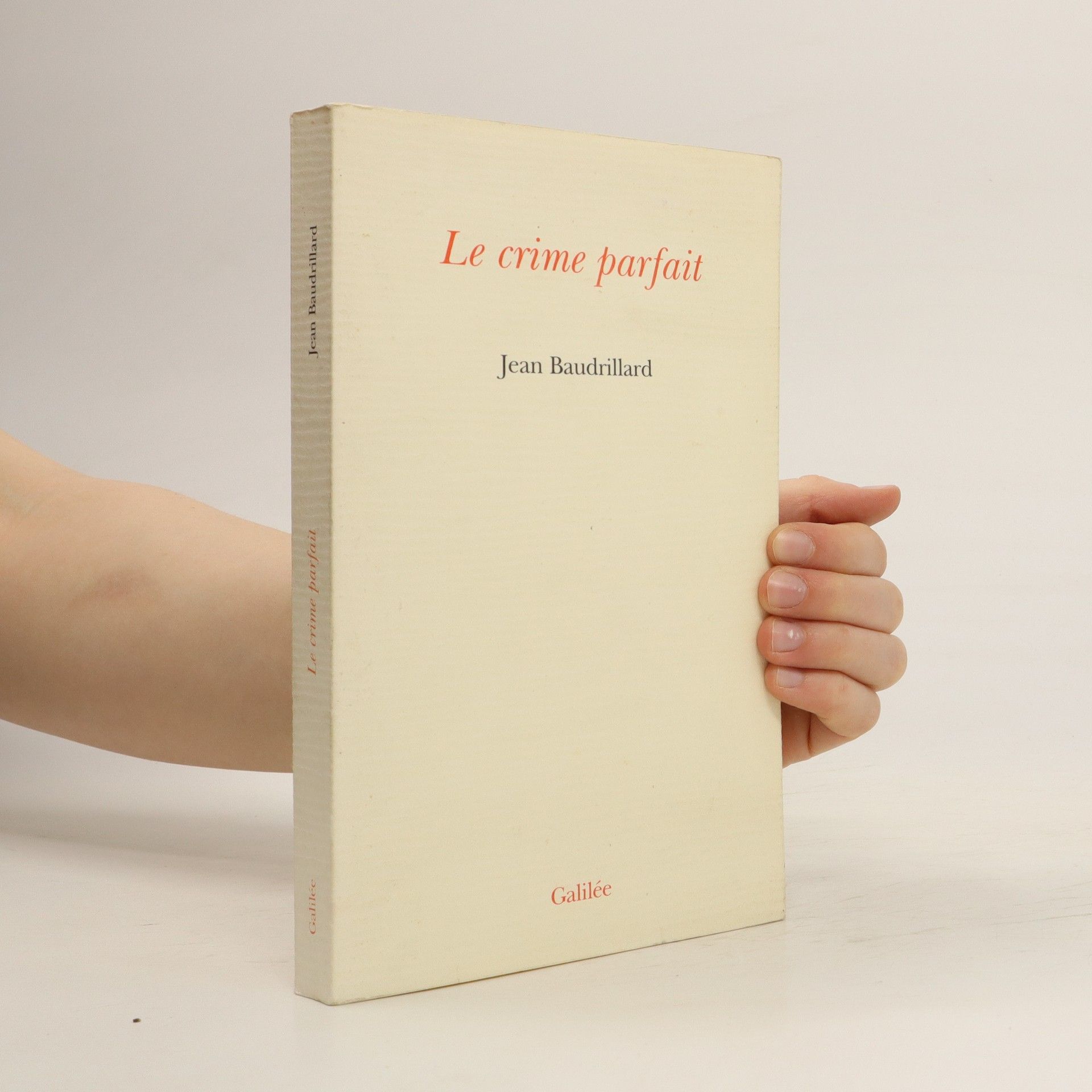
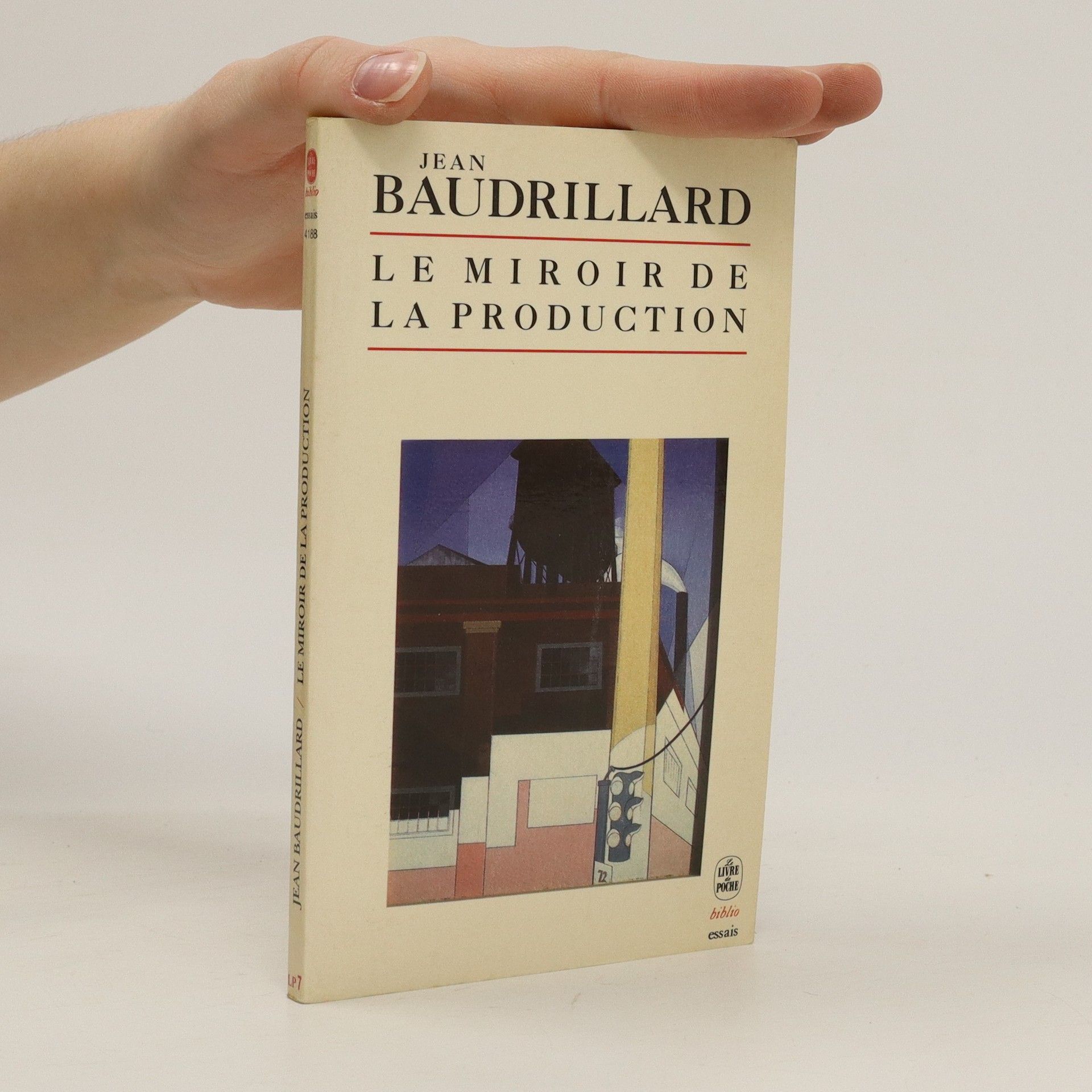

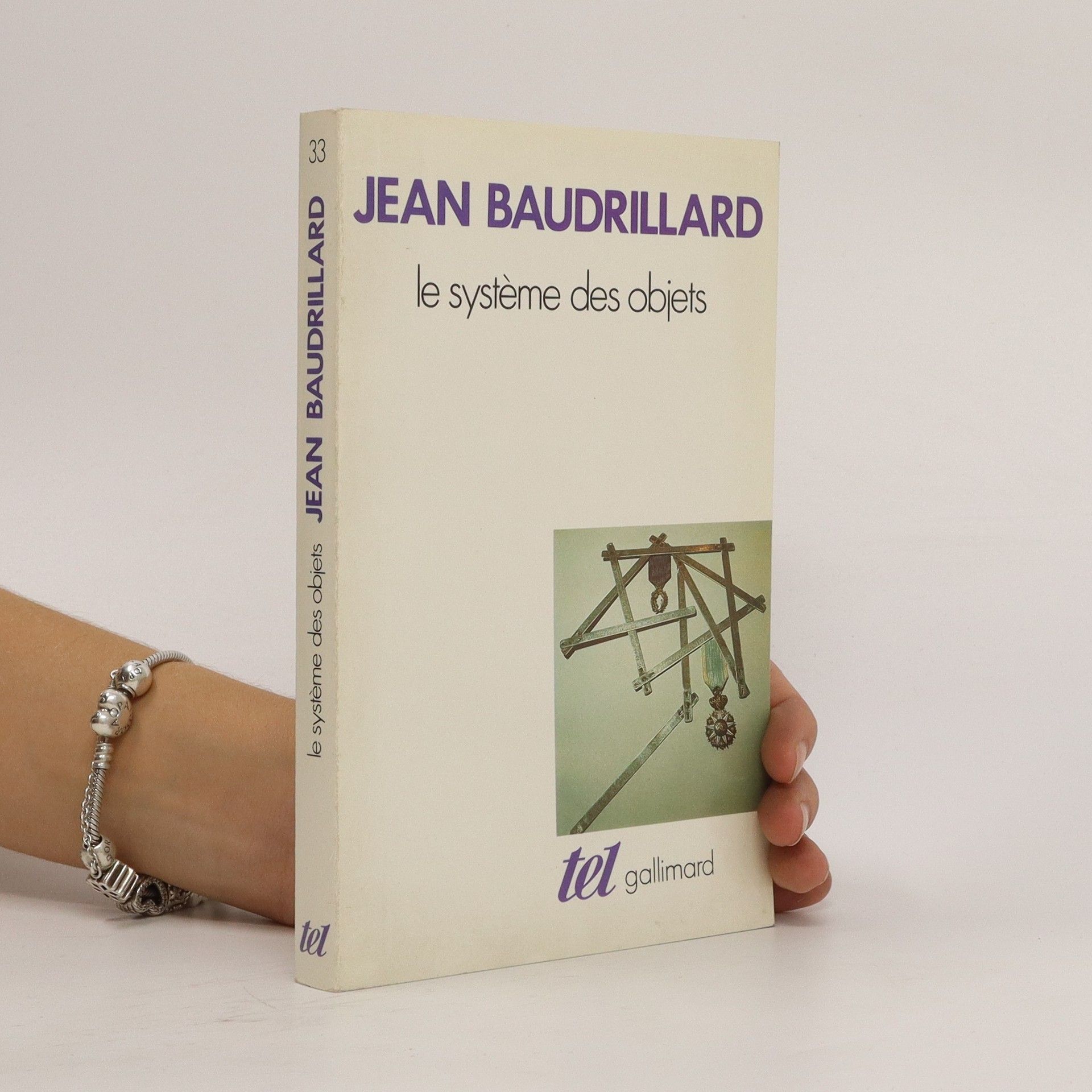
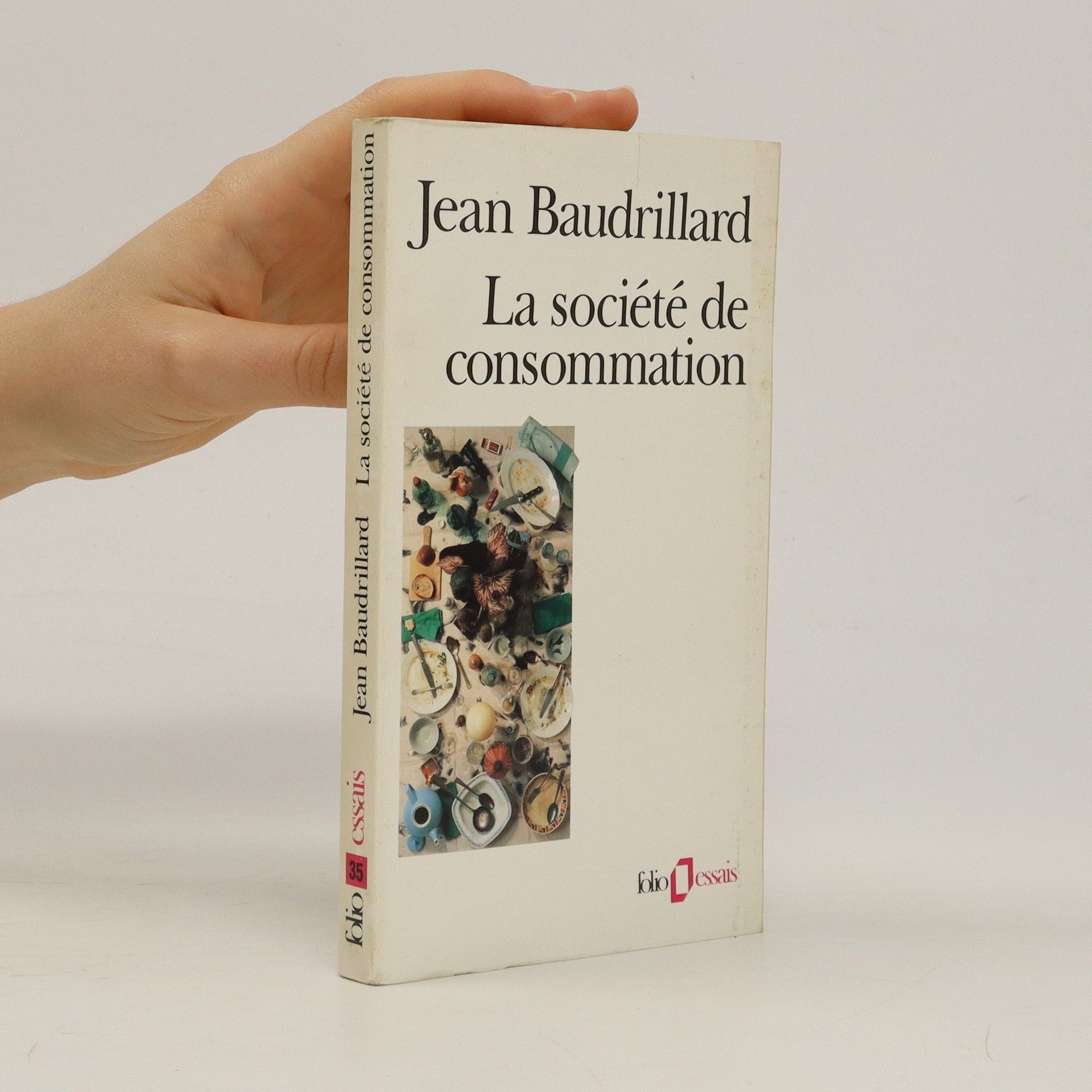
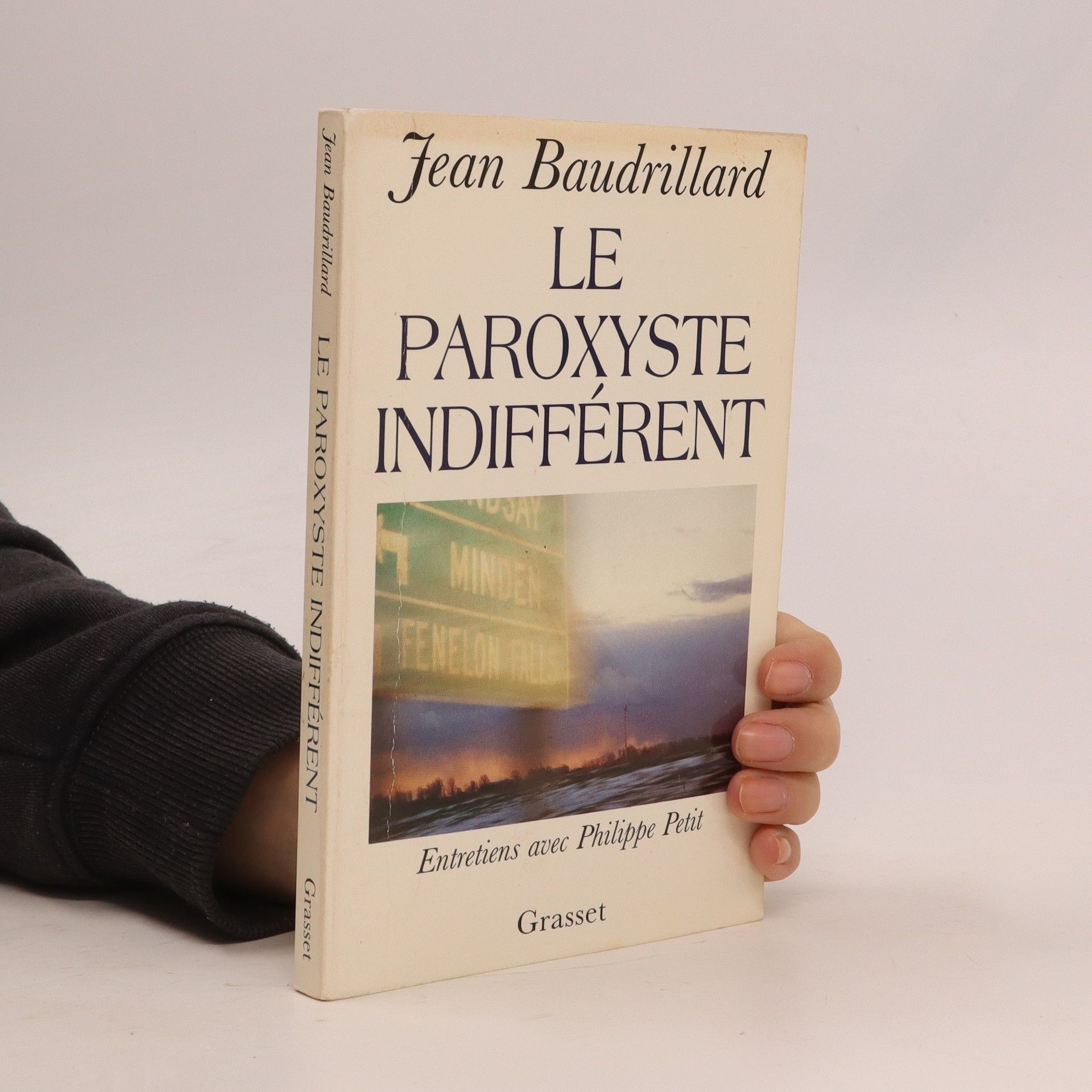
A material analysis of the sign which deepens Marx's critique of political economy for spectacular times.
”Симулякры и симуляция” - одна из важнейших работ выдающегося философа-постмодерниста, культуролога и социолога Жана Бодрийяра. Самая полная и доступная для восприятия книга подобной тематики, с которой можно начинать погружение в мир современной философии. Автор дает наиболее развернутые определения таким понятиям как, ”гиперреальность” и ”симулякры”, давно уже вошедших в массовый обиход. Это произведение помогло множеству людей по всему миру взглянуть на нашу реальность с принципиально иной стороны, с позиции признания ее фиктивной, поддельной, ”копией копии”, иллюзорной субстанцией, а также вдохновила кинематографистов на создание культового фильма ”Матрица”. Подробнее: https://akonit.net/ru/336998-simulyakry-i-simulyaciya
Jean Baudrillard je známy francúzsky postmoderný filozof, sociológ a fotograf. V knihe Heslá spôsobom autokomentára vysvetľuje sám seba, resp. základné pojmy, ktoré vo svojich ostatných knihách (Symbolická výmena a smrť, Priezračnosť zla, Simulakra a simulácia, Amerika, Zabudnúť na Foucaulta, atď.) filozoficky rozpracoval (podobe ako to svojho času urobil G. Deleuze vo svojom Abecedaire). Pojmy, ktoré Baudrillard v knihe slovníkovým spôsobom objasňuje, sú: objekt/predmet, hodnota, symbolická výmena, zvádzanie, aleatorickosť, virtualita, chaos, hranica, dokonalý zločin, osud, myslenie, obscénnosť, virtualita, priezračnosť zla, dualita. Štruktúra knihy je teda daná slovníkovým, abecedným zoradením jednotlivých hesiel za sebou. Všetky uvedené heslá sa priebežne objavujú v rozmanitých variáciách vo viacerých Baudrillardových textoch. Baudrillard zatiaľ do slovenčiny nebol preložený, predkladaná kniha je jeho prvý slovenský preklad.
The book provides a critical analysis of François Mitterrand's ascent to power and the allure of political authority for the French Left. It chronicles the political landscape of France from 1977 to 1984, examining the complex relationship between the Socialist Party and the Communist Party. Through a collection of previously published commentaries, it explores Baudrillard's concept of simulacrum in politics, revealing how political narratives can distort reality and influence public perception.
Baudrillard's "The Ecstasy of Communication" is a pivotal work summarizing two decades of his radical theory, reflecting on contemporary alienation and the shift from meaningful existence to constant communication. This anti-manifesto critiques influences like McLuhan and remains a crucial companion to Baudrillard's oeuvre, offering a dark reflection on modernity.
The book explores the concept of self-deterrence among Western powers, suggesting that traditional deterrence strategies have been internalized, leading to an inability to effectively utilize their own power. This internalized deterrence creates a paradox where the very measures intended to prevent conflict hinder the realization of military and political strength, impacting international relations and the dynamics of power.
The art of living today has shifted to a continuous state of the experimental. In one of his last texts, Telemorphosis, renowned thinker and anti-philosopher Jean Baudrillard takes on the task of thinking and reflecting on the coming digital media architectures of the social. While "the social" may have never existed, according to Baudrillard, his analysis at the beginning of the twenty-first century of the coming social media-networked cultures cannot be ignored. One need not look far in order to find oneself snared within some sort of screenification of a techno-social community. "What the most radical critical critique, the most subversive delirious imagination, what no Situationist drift could have done . . . television has done." Collective reality has entered a realm of telemorphosis.
Quintessential thinker of the postmodern on the uniqueness of all things